Introduction à pytorch#
Ce notebook commence par une introduction à PyTorch, une bibliothèque très populaire dans le domaine du deep learning. On va reprendre le réseau de neurones du notebook précédent et l’implémenter en PyTorch.
import random
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Import classiques des utilisateurs de pytorch
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
Dataset et Dataloader#
On va reconstruire un dataset de manière similaire au notebook précédent. Il faut aussi convertir les X et y en tenseurs (équivalent de Value dans micrograd).
# Initialisation du dataset
from sklearn.datasets import make_moons
X, y = make_moons(n_samples=100, noise=0.1)
X=torch.tensor(X).float() # Conversion en tensor pytorch (équivalent de Value)
y=torch.tensor(y).float() # Conversion en tensor pytorch
y = y*2 - 1
plt.figure(figsize=(5,5))
plt.scatter(X[:,0], X[:,1], c=y, s=20, cmap='jet')
<matplotlib.collections.PathCollection at 0x7c6677d37350>
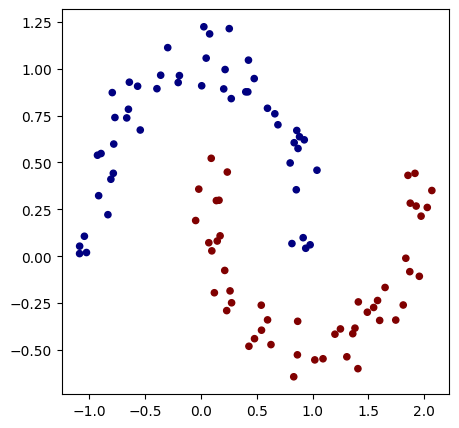
Maintenant, utilisons les fonctionnalités de PyTorch pour créer notre dataset et notre dataloader. Le dataset regroupe simplement les entrées et les labels, tandis que le dataloader simplifie l’utilisation de la descente de gradient stochastique en fournissant directement un mini-batch de données aléatoires issues du dataset (le dataloader est un itérateur).
from torch.utils.data import TensorDataset, DataLoader
# Création d'un dataset qui stocke les couples de valeurs X,y
dataset = TensorDataset(X, y)
# Création d'un dataloader qui permet de gérer automatiquement les mini-batchs pour la descente de gradient stochastique.
dataloader = DataLoader(dataset, batch_size=32, shuffle=True)
Pour en apprendre plus sur le dataset et le dataloader, vous pouvez consulter la documentation de pytorch.
Construction du modèle#
Maintenant, construisons notre modèle avec 2 couches cachées.
Pour cela, nous allons créer une classe MLP qui hérite de la classe nn.Module. Ensuite, nous construisons les couches du réseau grâce à la fonction nn.Linear(in_features, out_features), qui crée une couche entièrement connectée prenant en entrée in_features et renvoyant en sortie out_features. C’est une couche composée de out_features neurones connectés à in_features entrées.
class mlp(nn.Module):
def __init__(self, *args, **kwargs) -> None:
super().__init__(*args, **kwargs)
self.fc1=nn.Linear(2,16) # première couche cachée
self.fc2=nn.Linear(16,16) # seconde couche cachée
self.fc3=nn.Linear(16,1) # couche de sortie
# La fonction forward est la fonction appelée lorsqu'on fait model(x)
def forward(self,x):
x=F.relu(self.fc1(x)) # le F.relu permet d'appliquer la fonction d'activation ReLU sur la sortie de notre couche
x=F.relu(self.fc2(x))
output=self.fc3(x)
return output
model = mlp() # Couches d'entrée de taille 2, deux couches cachées de 16 neurones et un neurone de sortie
print(model)
print("Nombre de paramètres", sum(p.numel() for p in model.parameters()))
mlp(
(fc1): Linear(in_features=2, out_features=16, bias=True)
(fc2): Linear(in_features=16, out_features=16, bias=True)
(fc3): Linear(in_features=16, out_features=1, bias=True)
)
Nombre de paramètres 337
On a bien le même nombre de paramètres que dans le notebook précédent où on avait utilisé micrograd.
Fonction de perte#
En PyTorch, certaines fonctions de perte sont déjà implémentées dans la bibliothèque. Avant d’implémenter votre propre fonction, vérifiez si elle existe déjà.
Ici, nous allons utiliser la fonction torch.nn.MSELoss de PyTorch. Il s’agit de la perte suivante : \(\text{MSE}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2\) où \(y_i\) est la valeur réelle (label), \(\hat{y}_i\) est la valeur prédite et \(n\) est le nombre total d’exemples du mini-batch.
En PyTorch, cette fonction de perte s’implémente facilement :
criterion=torch.nn.MSELoss()
Entraînement#
Pour l’entraînement, définissons les hyperparamètres et l’optimizer. L’optimizer est une classe PyTorch qui spécifie la méthode de mise à jour des poids lors de l’entraînement (mise à jour des poids du modèle et learning rate). Il existe plusieurs optimizers : SGD, Adam, Adagrad, RMSProp, etc. Nous utilisons SGD (Stochastic Gradient Descent) pour reproduire les conditions d’entraînement du notebook précédent, mais en pratique, on préfère souvent utiliser Adam (Adaptive Moment Estimation). Pour en savoir plus sur les optimizers et leurs différences, vous pouvez consulter le cours bonus sur les optimizers, la documentation PyTorch ou le blogpost.
# Hyper-paramètres
epochs = 100 # Nombre de fois où l'on parcoure l'ensemble des données d'entraînement
learning_rate=0.1
optimizer=torch.optim.SGD(model.parameters(),lr=learning_rate)
/home/aquilae/anaconda3/envs/dev/lib/python3.11/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html
from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm
On peut également utiliser un scheduler qui modifie la valeur du learning rate au cours de l’entraînement. Cela peut accélérer la convergence en commençant avec un learning rate élevé et en le réduisant progressivement. Pour avoir un learning rate qui diminue au cours de l’entraînement, comme dans l’exemple micrograd, on peut utiliser LinearLR. Pour en savoir plus sur les différents types de scheduler, vous pouvez consulter la documentation PyTorch.
scheduler=torch.optim.lr_scheduler.LinearLR(optimizer=optimizer,start_factor=1,end_factor=0.05)
for i in range(epochs):
loss_epoch=0
accuracy=[]
for batch_X, batch_y in dataloader:
scores=model(batch_X)
loss=criterion(scores,batch_y.unsqueeze(1))
optimizer.zero_grad()
loss.backward()
optimizer.step()
#scheduler.step() # Pour activer le scheduler
loss_epoch+=loss
accuracy += [(label > 0) == (scorei.data > 0) for label, scorei in zip(batch_y, scores)]
accuracy=sum(accuracy) / len(accuracy)
if i % 10 == 0:
print(f"step {i} loss {loss_epoch}, précision {accuracy*100}%")
step 0 loss 0.12318143993616104, précision tensor([100.])%
step 10 loss 0.1347985863685608, précision tensor([100.])%
step 20 loss 0.10458286106586456, précision tensor([100.])%
step 30 loss 0.14222581684589386, précision tensor([100.])%
step 40 loss 0.1081438660621643, précision tensor([100.])%
step 50 loss 0.10838648676872253, précision tensor([100.])%
step 60 loss 0.09485019743442535, précision tensor([100.])%
step 70 loss 0.07788567245006561, précision tensor([100.])%
step 80 loss 0.10796503722667694, précision tensor([100.])%
step 90 loss 0.07869727909564972, précision tensor([100.])%
L’entraînement est beaucoup plus rapide !
On peut visualiser les résultats sur nos données :
h = 0.25
x_min, x_max = X[:, 0].min() - 1, X[:, 0].max() + 1
y_min, y_max = X[:, 1].min() - 1, X[:, 1].max() + 1
xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, h),
np.arange(y_min, y_max, h))
Xmesh = np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()]
inputs=torch.tensor(Xmesh).float()
scores=model(inputs)
Z = np.array([s.data > 0 for s in scores])
Z = Z.reshape(xx.shape)
fig = plt.figure()
plt.contourf(xx, yy, Z, cmap=plt.cm.Spectral, alpha=0.8)
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, s=40, cmap=plt.cm.Spectral)
plt.xlim(xx.min(), xx.max())
plt.ylim(yy.min(), yy.max())
(-1.6418534517288208, 2.108146548271179)

Comme vous pouvez le voir, l’entraînement s’est bien déroulé et nous avons une bonne séparation des données.